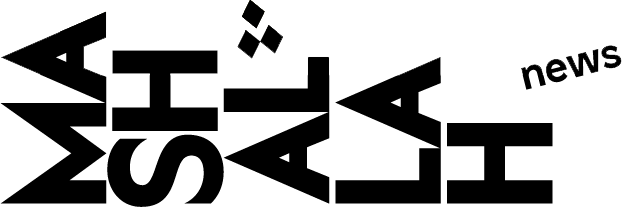De la graphie arabe à l’alphabet latin
Partie 2
Dans cette deuxième partie d’interview, Clément Girardot aborde avec Emmanuel Szurek la question de l’impact de la réforme de la langue turque et les mesures concrètes mises en place pour implémenter celle-ci.

Quelles sont les implications linguistiques de la latinisation ?
Changer l’alphabet revient aussi à changer l’orthographe et à terme, le vocabulaire. C’est pour cette raison que les réformes de l’alphabet et de la langue sont liées. Avec la latinisation, c’est la traçabilité étymologique des mots arabes qui est cassée. Les mots sont orphelins de leur famille sémantique, ils n’ont plus la même capacité d’évocation et de connotation. La graphie latine déforme les mots arabes ; au contraire, elle facilite la transcription de mots issus des langues latines. La latinisation a donc favorisé l’entrée en masse dans la langue turque de mots d’origine occidentale. C’est l’un des grands paradoxes de la réforme de la langue. On passe son temps à dire que l’on va émanciper la langue des tutelles étrangères. On présente les mots et les structures syntaxiques arabes et persanes comme étant une « invasion » étrangère, que l’on assimile à l’occupation des armées alliées pendant la Première Guerre mondiale.
Quelle a été l’ampleur des conséquences de la réforme sur la langue turque, au-delà de l’alphabet ?
Aujourd’hui, un étudiant de 18 ans ne comprendra pas forcément un texte écrit dans les années 1940 ou même dans les années 1950 sans dictionnaire. En caricaturant, on peut dire que certains textes des années 1570 en France (les Essais de Montaigne, par exemple), ont le même statut que certains textes littéraires ou même scientifiques du milieu du XXème siècle en Turquie. C’est lié à la réforme de la langue, à la purification du vocabulaire menée depuis les années 1930 jusqu’aux années 1970, c’est-à-dire au remplacement en masse des mots arabes et persans par des néologismes de « turc pur », à la création et l’importation de nouveaux mots. Le lexique a tellement changé que l’ancien vocabulaire est devenu incompréhensible à la majorité des Turcs d’aujourd’hui.
Qu’est-ce que cette réforme reflète comme vision du monde arabo-persan ?
Les kémalistes ont totalement intériorisé la vision occidentale de « l’Orient » et produit leur propre orientalisme à l’égard du monde arabe. Cela existait déjà sous l’Empire ottoman. Le progressisme kémaliste s’est opposé à l’Orient dit « rétrograde », au « fanatisme » et à « l’arriération » des sociétés arabes. Cela s’explique par la sociologie des cadres kémalistes. Ils sont proches de la culture occidentale et tout particulièrement française. Ils ont intériorisé, si ce n’est une haine de soi, au moins une haine de l’Orient très forte. Ils veulent rompre avec l’Orient pour « entrer » dans la « civilisation » occidentale. Mais ce n’est pas la seule explication : l’orientalisme des kémalistes s’explique aussi par leur nationalisme exclusif et ethniciste, par la volonté qui est la leur de construire une société homogène, nationale, turquifiée, notamment au détriment des minorités de culture kurde.
Le registre à travers lequel les historiens, journalistes et publicistes officiels de l’époque expliquent le changement d’alphabet est celui de la révélation religieuse (nurlanma): il y a une sorte de transfert de sacralité de l’alphabet arabe, l’alphabet coranique, vers le nouvel alphabet turc. Mustafa Kemal c’est le prophète, au sens étymologique du terme, celui qui parle avant, celui qui apporte la bonne nouvelle (müjde). Toute la construction du discours kémaliste va consister à opposer précisément ce qu’il y avait avant 1928, l’obscurité, l’ignorance, la superstition, par rapport à l’après, la lumière, le savoir, la connaissance. C’est en quelque sorte un décalque de la théologie islamique qui établit une distinction très forte entre avant la révélation mahométane, les âges obscurs, et après.
Comment a été mise en œuvre la réforme ?
Dans un contexte où la majorité des élites traditionnelles, notamment intellectuelles, sont hostiles à la réforme de l’alphabet, le pouvoir adopte une stratégie de contournement. On passe par le champ politique qui est beaucoup mieux contrôlé que le champ académique. Donc, on crée une commission d’intellectuels proches du régime en juin 1928, qui rend un rapport légitimant la latinisation. La réforme a été mise en œuvre dans l’État, par l’État, pour l’État. Elle se diffuse à partir des hauts fonctionnaires dans toutes les administrations. Ensuite, à l’automne 1928, les fonctionnaires passent des tests sur l’alphabet. S’ils échouent, ils sont licenciés.
La purification de la bureaucratie permet l’imposition d’une norme. C’est là qu’on voit que la censure est complexe. La censure politique en place depuis 1925 va être doublée d’une autre censure que j’appelle « censure de second degré » ou « métacensure », qui impose aux gens qui veulent prendre la parole contre le régime de le faire dans les normes et les formes imposées par le régime lui-même.

Comment a réagi la population ? Avec bonne volonté ou a-t-elle résisté ?
Du fait de la censure, les seules sources dont nous disposons sont les sources d’État. Les « écoles de la nation » (Millet Mektepleri) sont créées à partir de décembre 1928 pour alphabétiser tous les individus âgés de 16 à 40 ans qui ne savent ni lire ni écrire. La réalité est sûrement différente mais selon les statistiques officielles en 1935, 2,5 millions de personnes sont passées par les « écoles du peuple » et 1,2 millions en sont sorties diplômées, sur 13 millions d’habitants.
Il est certain que le climat de coercition a été fort. L’enjeu était que le nombre de nouveaux lettrés dépasse rapidement celui de ceux qui maîtrisent la graphie arabe, afin qu’il soit impossible de revenir en arrière. Selon les statistiques officielles, en 1927, la Turquie comptait 10% d’alphabétisés contre 20% en 1935. Même si l’on peut discuter les chiffres, c’est un phénomène massif et inouï. Les résistances sont difficiles à percevoir. L’exemple que j’aime bien est celui d’un tailleur de pierre qui a un procès en 1932 parce qu’il continue d’inscrire le nom des défunts en caractères arabes sur les pierres tombales. Comme si la mort ne pouvait être dissociée de la sacralité attachée à la graphie coranique.
Cette reconstruction de la langue, ça fait tout de même un peu penser à George Orwell ?
Oui, sauf que chez Orwell il y a seulement le côté dictature, le contrôle des cerveaux. Certes, changer un mot c’est changer le réel, cela a un côté orwellien mais la réforme a aussi permis un accès à la connaissance, à la culture et à la maîtrise de l’écrit. Ce changement a eu des effets émancipateurs. Dans la lecture tiers-mondiste et progressiste en vogue dans les années 70-80, on s’extasiait devant l’alphabétisation, le progrès et le « développement » alors que maintenant on est presque dans la logique inverse : « C’est formidable les cultures orales et les traditions ! ». On fustige la « modernité », on cultive la nostalgie du « patrimoine » détruit, dont on entretient une représentation fantasmatique. Il faut trouver un équilibre, cette réforme, si violente qu’elle fût, symbolise aussi la destruction des structures féodales, des oppressions religieuses, et l’accès des individus à l’information.