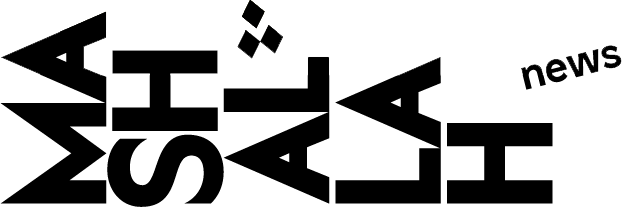Aux yeux du monde et en silence

Dheisheh, camp de réfugiés
9 août, 2013
Leila a cinq ans. Dans son petit tee-shirt jaune fluo et sous ses barrettes multicolores qui ornent ses cheveux, elle descend la rue en pente, la main dans celle de Karen, douce Anglaise de quarante-neuf ans – ma mère de Palestine. Karen vit avec nous, à la ferme, là-bas dans la montagne. C’est elle qui s’occupe des repas, du linge et d’un peu plus ; de nous. Sa voix, sucrée comme un bonbon aux amandes, ressemble aux mélodies d’antan, qui apaisent les nourrissons au coucher. Ces derniers jours, elle vient de les passer chez la petite fille qui lui sert fort les doigts. C’était l’Aïd, c’était la fête au camp de Dheisheh. C’est là que se trouve la maison de Leila, dans le troisième camp de réfugiés de Bethléem ; le plus grand.
Une porte en métal, un semblant de jardin, un arbre, quelques oiseaux et la maison est là. Pas grand-chose sur les murs, trois petits canapés, des chambres au mobilier réduit ; très vite on nous installe et nous offre le café, puis le thé. Wael et Maissa ont cinq enfants, dont Leila, tous plus joviaux les uns que les autres. Wael est peintre, alors il a pris soin de donner à sa maison des couleurs vives, gaies et chaleureuses : du jaune, du bleu, du rouge. Mais les portes sont brinquebalantes, il fait trop chaud en été, trop froid en hiver… Maissa, elle, ressert du thé et deux autres amis arrivent : Johannes et Karel, eux aussi de la ferme où je vis, d’où je viens et où je retourne toujours. Maissa travaille dans une école où elle s’occupe des repas. Un petit salaire qui permet à la famille de tenir, de respirer et grandir. Wael, lui, ne travaille pas ; il n’y a plus de travail ici.

D’où vient-il, quelle est son histoire ? La Nakba, l’exode de ses parents, l’arrivée au camp qui, en 1950, n’était fait que de toiles et de tentes. Aujourd’hui c’est un village, collé à la ville, où les rues n’ont pas de nom et les portes aucun numéro. Il faut éviter que l’armée ne puisse localiser trop facilement les habitants… et pourtant, ils viennent ici, tracer des cartes pour mieux enlever des visages. Ils viennent une, deux, parfois trois fois par semaine, tantôt en tenues militaire, tantôt en tenue civile, et ils enlèvent un homme, jeune ou pas, qu’importe. Et un frère disparait, un père, un oncle, un fils, pour 24 heures de prison, deux jours, deux semaines, deux mois, deux ans… Les raisons sont multiples, ne sont pas, ne sont plus. Il suffit qu’on ait ouï-dire que l’homme a jeté une pierre, et aucune preuve ne sera nécessaire pour punir le criminel qui a (peut-être, peut-être pas) osé protester contre le mur diviseur, un mur non approuvé par la communauté internationale. Cette semaine encore des hommes ont disparu, à Ramallah, à Naplouse, à Bethléem. Mais qu’importe, c’est normal. Il faut éradiquer la race vile qui, sans armée, sans état, sans représentants de son unité, sans pouvoir, sans eau, sans électricité et sans droits, ose protéger sa maison, sa famille et survivre.
Karen me rapporte les histoires d’ici, quand un jour des soldats sont entrés dans la maison, en pleine nuit. Il fallait vérifier des papiers, des identités, et le bébé de Maissa pleurait. Alors un jeune, le casque vert kaki sur le crâne, a pris dans ses larges bras le petit effrayé et l’a bercé plus loin, au bout du jardin, le temps que ses collègues finissent le travail. « Quel gentil soldat. » avait soufflé Maissa. Jeune mère, elle voudrait apaiser cette jeunesse qui vient dans sa maison pour vérifier ce qui ne sert à rien, pour effrayer ceux qui n’ont pas à l’être. Mais ils semblent piégés par un conflit dont le sens est perdu depuis bien trop d’années. Alors Maissa attend en silence que cela passe et que ses enfants puissent un jour partir à la mer, au-delà des frontières et revenir serein dans un pays en paix.

Wael nous emmène à travers les ruelles pour nous faire visiter son village et ses secrets. Des enfants, toujours, qui jouent à la guerre derrière les murets et les contre-allées. À part leur frimousse, le village dort, fatigué de l’Aïd… et Wael déguste, tout sourire, le silence trop rare de son quartier. Des baraques en tout genre ; même quelques réfugiés ont depuis fait fortune et vivent dans des murs plus luxueux que les autres. Tous pourtant subissent les mêmes restrictions ; l’eau ne coule pas toujours et l’électricité s’amuse. Plus haut, les beaux-parents de Wael nous ouvrent grand l’entrée de leur salle à manger et, de nouveau, on est invité à déguster le thé. Une clé, en point de croix, est encadrée sur le mur. La clé de leur maison, quelque part, pas si loin, où ils espèrent rentrer un jour, si Dieu le veut. Mais ils ne sont pas religieux, ni chrétiens, ni musulmans. Dieu n’a pas toujours sa place dans le pays saint et saignant.
Comme 97% de réfugiés du pays, ils vivent à moins de 100 kilomètres de leur maison.
Comme 50% d’entre eux, ils vivent à moins de 40 kilomètres de leur village.
Savent-ils que près de 90% des villages palestiniens, évacués jadis, sont vides à présent ?
Ces maisons volées au prix du sang, de la peur et de l’effroi, il y a 65 ans déjà. Mais à la ville, au bord de la mer, la ville qui ressemble à Miami, à Los Angeles, à Nice, à Monaco, à Biaritz, là-bas, à Tel Aviv et de part et d’autre d’Israël, on croit que « Nakba » est le mot arabe pour « Jour d’indépendance » quand cela n’est que « catastrophe ». Là-bas on croit que les ruines du pourtour de la ville et des alentours datent des temps romains quand ce ne sont que les vestiges des maisons de ceux qui, aujourd’hui, vivent entassés dans des ghettos. Et l’Histoire s’inscrit, vertigineuse, aux yeux du monde et en silence.