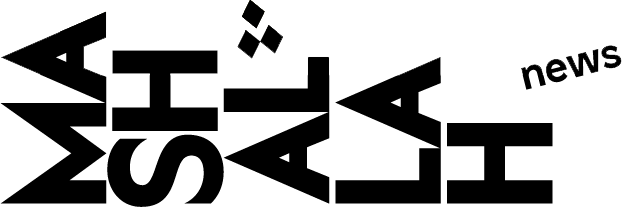Interview avec Turbo
L'artiste graffiti d'Istanbul

Depuis plus de vingt ans, Turbo Tunç Dindaş laisse son empreinte sur les murs d’Istanbul. Né en 1971, il est le pilier de la scène graffiti en Turquie. Alors que les modes se sont succédées, que de nouvelles têtes sont arrivées et des anciens sont partis, Turbo est resté fidèle à sa passion pour le graffiti. Dans un article dédié aux pochoirs, nous avions reçu un commentaire d’Ali : « La vérité c’est que tout ce que l’on peut trouver autour de Taksim est plutôt mauvais. Pour le bon graffiti, vous devriez regarder les travaux de Tunç Dindaş ». Mashallah news est donc allé à la rencontre de Turbo pour discuter du graffiti et des cultures urbaines à Istanbul.
Comment avez-vous commencé le graffiti ?
En 1984, je faisais un peu de breakdance. A la même époque, j’ai vu pour la première fois des graffiti sur les pochettes des disques vinyles et j’ai regardé le film Beat Street qui m’a permis de comprendre comment faire des graffiti. C’est ainsi que j’ai commencé, et j’ai continué après que le breakdance soit passé de mode. Je suis le premier graffeur de Turquie et le seul de ma génération qui fasse encore des tags. En ce moment, je travaille comme publicitaire pour des grandes entreprises, je fais des clips vidéos. Pendant mon temps libre, je prépare des expositions et je publie des livres sur le graffiti.

Après le coup d’État militaire de 1980, ce n’était pas trop dangereux de faire du graffiti ?
Bien sûr, c’était dangereux. En 1988, je me suis fait attraper par la police. Ils m’ont condamné à un an et demi de prison. Au final, je n’ai pas été incarcéré, j’ai seulement payé une grosse amende. Dans les années 80, tout ce qui était écrit sur les murs était perçu comme politique et il est vrai que de nombreux groupes de militants peignaient des slogans dans les rues. Même, une fois j’avais écrit le mot « Peace » et la police m’a demandé si je n’étais pas communiste ou gauchiste. Ensuite, après l’année 1995 et la sortie du disque Cartel du groupe de rap éponyme, le mouvement hip hop s’est développé et est devenu plus reconnu à Istanbul.
Comment étaient les graffiti à cette époque en Turquie ?
Les premiers graffiti datent de 1985. Il n’y avait alors que des bombes de peinture d’une seule couleur : le blanc, pour peindre les réfrigérateurs. Pendant longtemps, la variété des couleurs disponibles était très restreinte et la plupart des graffiti en Turquie étaient gris ou bleus. Impossible de trouver du violet ou un joli vert. Il était difficile de faire ce que l’on voulait, le style restait très basique. Maintenant la situation est bonne, des magasins spécialisés ont ouvert leurs portes et toutes les différentes bombes de peinture sont importées.

Est-ce vous voulez délivrer un message dans vos graffiti ?
On me pose souvent cette question et je réponds tout le temps qu’il y a déjà beaucoup de gens qui veulent transmettre des messages en Turquie. Moi, je ne le fais pas, j’écris juste mon blase ou celui de mon crew S2K.
Pendant les 30 dernières années, Istanbul est devenue une métropole de 15 millions d’habitants. Comment analysez-vous l’état de la culture urbaine dans cette ville si grande ?
C’est vraiment insuffisant. Istanbul est une ville immense mais la scène graffiti est relativement petite. Ici, les salaires sont bas : les gens travaillent toute l’année et ne peuvent même pas se payer des vacances en Turquie. En raison de ces problèmes d’argent récurrents, ils ne donnent pas d’importance aux activités artistiques. Même si l’art n’est pas réservé aux riches, cela peut être une des raisons expliquant que le graffiti est peu développé à Istanbul. En plus, les bombes de peinture coûtent cher aujourd’hui. Dans les années 80, tu pouvais voler de la peinture dans les magasins de bricolage mais maintenant il existe des marques spécifiques vendues dans des petites boutiques dont le patron est généralement un ami. Donc, tu ne vas pas le voler !

En Amérique du Sud, la peinture murale est un art très populaire. Dans les banlieues françaises, le hip hop et le graffiti se sont développés parmi les groupes sociaux les plus défavorisés.
Il n’existe pas une telle culture urbaine en Turquie. A l’étranger, dans les banlieues, il existe un style vestimentaire à part entière. Ici, ce n’est pas pas seulement le graffiti qui est peu développé, c’est toute la culture alternative : le skateboard, le rock ou le heavy metal sont aussi peu implantés. La scène alternative fait face à de nombreux obstacles, elle ne grossit pas. Je pense que la raison est que les gens en Turquie ne s’investissent pas dans la culture underground avec passion. Ils la voient plutôt comme une mode et certains veulent juste se donner un genre : « Je fais un peu de breakdance. Je flirte avec les filles, c’est cool ! » Mais il n’y a pas d’âme.
Cela peut-il être lié au coup d’État de 1980 qui a eu un impact très négatif sur la vie culturelle et intellectuelle en Turquie ?
D’après moi, il y a eu bien peu d’influence étrangère en Turquie jusqu’aux années 80, comme si le pays était sous un embargo. La Turquie était plutôt renfermée sur elle-même. Je collectionne les vinyles et quand on regarde ce qui sortait alors, il y a du rock et de la pop mais très peu de funk. Les disques de James Brown étaient plutôt rares. Le funk n’est pas arrivé jusqu’ici et encore aujourd’hui il n’existe pas de groupe turc de funk.
Après l’arrivée de Turgut Özal au pouvoir en 1983, tout a changé d’un coup. La consommation de masse a débarqué en Turquie. Quand quelque chose de nouveau arrive ici, les gens le consomment très rapidement et le phénomène s’arrête aussi brusquement qu’il a démarré. Les modes changent très vite. Au contraire, pour construire une scène culturelle, il faut de la passion. Ce n’est pas juste un loisir. Je suis né en 1971, j’ai 40 ans, un métier et de l’argent mais je fais encore du graffiti. C’est en moi !