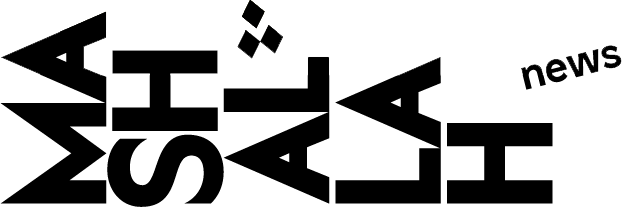Interview avec Bahrâm Zand
Bahrâm Zand, doubleur confirmé de célèbres films et séries télévisées étrangers ou iraniens tels que Navarro ou Sherlock Holmes, possède une voix connue de tous les Iraniens, une voix avec laquelle ils ont grandi, pleuré et ri.
Vous avez commencé très jeune le doublage. Comment vous êtes-vous orienté vers ce métier ?
Je me suis toujours intéressé à la présentation des films. Étant donné la particularité de ma voix, on m’encourageait souvent à passer l’examen d’entrée, en m’assurant que je réussirais. Chaque fois que je commençais à parler, mon entourage se taisait pour m’écouter. Un jour je me suis rendu à l’association des présentateurs pour passer l’examen. A l’époque, il fallait faire un stage chez les professionnels et les pionniers de ce métier afin d’adapter sa voix au rôle prévu, d’apprendre à traiter la voix et de la raffiner pour qu’elle soit claire malgré les parasites. De cette façon, j’ai suivi des stages et après plusieurs étapes, voilà presque 40 ans que je travaille dans ce domaine.
D’après vous, le doublage est-il un art ou une technique ?
Les deux ; je ne les considère pas comme des choses séparées. Vous ne trouvez aucun art qui ne soit accompagné de sa technique propre. Comme la musique et la poésie. En fait, chaque domaine artistique suit certaines règles spécifiques qui pourront s’adapter à votre état d’esprit, lequel présente un caractère unique. En apprenant la technique de chaque art, on prépare le terrain pour l’épanouissement de ce qui est caché et inconnu. Un musicien qui joue d’un instrument de musique ne fait rien d’autre que de suivre une pratique répétée et mathématique, mais au moment où ses doigts jouent vraiment la note, de par sa volonté, l’art apparaît. C’est le même cas pour le doublage. Une partie du doublage consiste en sa technique et l’autre est comme une inspiration qui réveille l’artiste. Ce phénomène en apparence facile est en réalité assez difficile à mettre en pratique.
Peut-on considérer le doublage comme une action où le jeu est mené par la voix ?
Oui, c’est exactement cela. Lors d’un doublage, nous faisons autant d’efforts que l’acteur lui-même, en évitant d’en dire plus que lui. Nous nous transformons en acteurs. Quand nous faisions le doublage du film Patriot, après le doublage d’une scène où le fils de Gibson meurt, le doubleur du rôle du père a quitté le studio et a pleuré à chaudes larmes, comme s’il était vraiment le père. Ou bien, au moment du doublage du film Le sixième sens, mesdames Shirzâd et Râdpour, affectées par la scène entre la mère et le fils, se sont mises à pleurer et, en tant que directeur du doublage, j’ai quitté le studio pour qu’elles soient à l’aise et expriment leur peine.
Notre métier ressemble quelque peu à celui du gardien de but dans le football ; ce dernier est chargé de défendre le but. Quand il réussit, cela reste inaperçu, mais dès qu’il échoue, on pense toujours qu’il aurait pu faire mieux. Cette règle s’applique aussi à nous. Si nous travaillons bien, cela ne se voit pas, mais un petit manquement se remarque énormément.
Quant à l’avenir des doubleurs, existe-t-il des assurances ?
Notre métier n’a pas de retraite. Si un jour, je perds ma voix, je serai fini. Une personne qui consacre toute sa vie à cette profession s’expose à un grand risque, comme une petite bulle à la surface de l’eau qui peut disparaître à tout instant. Comme si elle n’avait jamais existé. Beaucoup ont couru ce risque.
Certains de nos collègues choisissent ce métier en tant que job secondaire. Mais c’est uniquement quand c’est votre seule et unique profession que vous pouvez montrer tout votre potentiel. Pour moi, le doublage est mon métier ultime, et j’ai conscience du risque que je cours de tomber un jour malade, de perdre ma voix et donc mon emploi.
L’interview a été réalisée par Elâheh Hâdjâghâ Mohammad Zâdeh. Publié avec l’autorisation de La Revue de Téhéran.