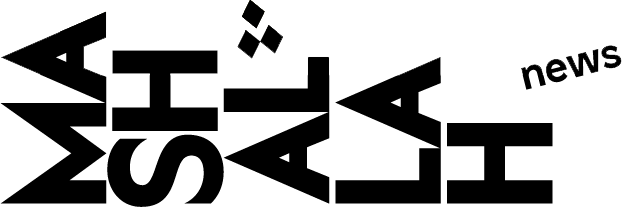Interview avec la documentariste Habiba Djahnine
Béjaïa Doc
Habiba Djahnine est documentariste. Née en 1968 en Kabylie, elle est militante politique et féministe durant les années 80 et 90. Le 15 février 1995, sa soeur Nabila est assassinée à Tizi-Ouzou : c’est la première fois qu’une féministe tombe sous les balles des islamistes lors de cette décennie noire.
“Lettre à ma soeur”, sorti onze ans plus tard, revient sur son parcours à travers des entretiens avec ses proches. Après ce premier film, diffusé dans de nombreux festivals, suivront d’autres films, qui tous poseront la question, directement ou indirectement : qu’est-ce que le militantisme ? Habiba Djahnine est également la fondatrice du festival de documentaires Béjaïa Doc, dont la 6e édition a commencé le 3 octobre dernier. Lancé en 2003, ces Rencontres du cinéma documentaire de Béjaïa allient visionnage de films et ateliers de formation. Carole Filiu a rencontré dans un café algérois cette femme hors norme.
Il n’y a pas de cinéma en Algérie, il y a seulement des cinéastes qui travaillent, c’est catastrophique !
“Il n’y a pas de cinéma en Algérie, il y a seulement des cinéastes qui travaillent, c’est catastrophique ! C’est très compliqué de produire un film dans ce pays, d’obtenir un financement de l’État, à cause de ses critères : il n’y a pas de liberté de création. Il existe un cinéma de commande, défini par le ministre de la culture. On en a l’exemple cette année avec Tlemcen 2011, capitale de la culture islamique: on reste dans une démarche de cinéma réalisé pour une occasion précise.
Dans tout ça, le terrorisme a bon dos. Car il y a une véritable volonté de museler toute la culture en Algérie. On essaie de créer quelque chose, à côté, avec des financements d’ONG par exemple, mais ce n’est pas encore une alternative. Pour faire de vrais films, il faut une volonté politique. Le public est en attente de films, mais il a perdu l’habitude d’aller au cinéma, d’autant plus qu’il n’y a pas de réseau de distribution et que la quasi majorité des salles ont fermé, comme à Alger. Nous avons essayé de monter un réseau de ciné-club mais c’est difficile. Quelques documentaires sont distribués à l’étranger et vivent surtout au sein des festivals. « Lettres à ma soeur », par exemple, a été beaucoup vu car j’ai moi-même organisé sa diffusion.
Car il y a une véritable volonté de museler toute la culture en Algérie.
Il n’y a pas véritablement de cinéma documentaire dans ce pays, on produit surtout de la fiction et du reportage. On doit être cinq ou six documentaristes, au regard très personnel. Il n’y a jamais eu de travail sur l’image en Algérie : les images viennent de l’extérieur et les jeunes ne s’y identifient pas. Il faut qu’ils les fabriquent eux-même. C’est pour ça que nous avons monté Bejaïa Doc en 2003 : c’est une formation qui accueille quatre à huit stagiaires pendant une année au cours de laquelle ils font un film. Chacun tourne dans sa ville, sur tout le territoire algérien, les résultats sont très variées selon les années ! Les Rencontres du film documentaire, en octobre de chaque année, sont un lieu de travail, de réflexion autour des projections, qui prolonge ce qui se fait dans l’atelier.

Le public a perdu l’habitude d’aller au cinéma.
Je ne suis plus militante
Au début des années 90, j’étais dans le premier noyau des féministes. Même si je me considère toujours comme féministe, je porte un regard très critique aujourd’hui sur l’évolution de ce mouvement, que j’essaie de saisir à travers mes films, les formations…
Il est très difficile de parler du militantisme. Le mouvement féministe a subi un clivage énorme en 1992 : certaines ont choisi de soutenir l’armée, d’autres ont continué sur le terrain le combat contre le pouvoir et la barbarie. On a assisté à la destruction acharnée de tous les lieux de réflexion de la société civile pendant les années 90. Le mouvement s’est vidé de sa masse militante et de son essence.
On a assisté à la destruction acharnée de tous les lieux de réflexion de la société civile pendant les années 90.
A partir des années 2000, les ONG sont arrivées avec leur culture : elles ont formé à l’européenne les cadres associatifs féminines, avec des plans d’action, etc. Il y a des choses très intéressantes dans ce magma comme le CIDEFF ( Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme) et le Réseau Wassila (réseau d’aide aux femmes victimes de violence). Aujourd’hui, il y a des bénévoles, mais il n’y a plus de militants. Les associations à dimension politique forte n’existent quasiment plus. Les militants constituaient les socles de la réflexion à l’intérieur de la société. Dans les années 80, ils étaient tout le temps dans la rue, ils participaient aux réunions politiques : c’était un mouvement social fort qui correspondait à une époque.
Aujourd’hui, il y a des bénévoles, mais il n’y a plus de militants. Les associations à dimension politique forte n’existent quasiment plus.
Personnellement, je suis engagée mais je ne suis plus militante, même si je reste très liée aux idées politiques. Des structures existent mais elles ne m’intéressent pas ; je ne suis plus liée à une région, dans un militantisme de fourmi. Je le considère plus comme un métier, dès qu’il se passe des choses graves comme par exemple à Hassi Messaoud, où je suis allée les soutenir, comprendre ce qui se passait. C’est une démarche personnelle alors que le militantisme rentre dans une démarche collective.
C’est dommage qu’il y ait un clivage entre société civile et partis politiques, cela montre qu’il y a une grande faiblesse dans la situation sociale. Elle est bien bousillée et il faudra des années pour que ça change : il y a une sorte de sidération par rapport à ce qu’il se passe. On n’arrive pas à exprimer ce que veut le peuple : il n’y a pas de projet social, pas de débat politique. Les gens ont envie de vivre après quinze ans de violence : et pour cela, il faut comprendre ce qu’il s’est passé ces dernières années.
Elles n’appartiennent à personne
A Hassi Messaoud, les femmes créent un nouvel espace, une nouvelle géographie de cette région, à travers leur façon d’habiter, de faire les courses, de travailler… Elles sont des soutiens de famille à 25-28 ans ! Elle ont des responsabilités incroyables. Elles choquent par cela car elles n’appartiennent à personne. Il s’agit d’un phénomène de masse complètement nouveau. Les femmes subissent des tensions mais veulent vivre comme ça, elles ont un courage exceptionnel. Certaines jeunes filles ont été violées mais ne veulent pas partir. Ça veut bien dire qu’elles y trouvent leur compte ! Elles n’ont aucune conscience collective, politique, mais sont solidaires entre elles. Il y a quelque chose de nouveau qui se dessine.”
Cet article a été publié sur le blog de Carole Filiu, Fatea.