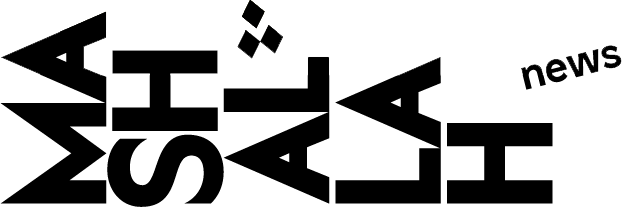J’irai crier à la mer

Prostitution, vol, trafic de drogue, crime, enlèvement. Des mots terribles qui ne nous concernent pas, sauf à travers un bon vieux roman ou un ciné le dimanche soir. Mais le juge a tranché, la peine est prononcée, c’est écrit noir sur blanc, à tout jamais, sur un bout de papier.
***
Un samedi midi, en plein mois d’août. Ma queue de cheval, que j’avais pris le temps de bien faire pour l’occasion, est plaquée sur ma joue et je sens les gouttes de sueur qui s’écrasent, l’une après l’autre, sur mon bras. L’énervement du chauffeur de taxi et les prêches du cheikh qui s’égosille sur les ondes Fm n’aident pas à calmer mon appréhension. Dans quelques minutes je serai en prison. Chaque semaine, pendant un an. Je commence à douter de mon choix et aussitôt les mots « prostitution », « vol », « meurtre » envahissent mes pensées.
***
L’air froid et sec de l’intérieur contraste violemment avec la chaleur quasi tropicale de la rue. Des policiers, une fouille classique, une porte en fer, une autre, de grosses clés et enfin un long couloir aux néons blancs et un silence… perturbant. Mon regard croise soudain une paire d’yeux qui me fixent à travers la petite fenêtre d’une cellule. Je n’arrive pas à déterminer ce qu’ils disent. Le regard est puissant mais il n’est pas hostile. Pas sympathique non plus. Elle doit avoir une cinquantaine d’années. Je saurai plus tard qu’elle s’appelle R., qu’elle a quatre enfants qui ont plus ou moins mon âge et qu’elle est incarcérée pour complicité de meurtre.
***
« Une photo c’est le reflet de la lumière, et pour parvenir au meilleur résultat, il faut jongler entre trois éléments de l’appareil photo… » Elles sont une dizaine, en demi-cercle autour de moi. Des Ethiopiennes, des Libanaises, des Sri-Lankaises, des Philippines… Je les regarde me regarder. Et mes mots me paraissent absurdes. « Vitesse d’obturation », « ouverture », « ISO » ou « focus »… Et à nouveau les foutus mots qui me hantent. « Vols », « fuite », « violence sur autrui », « falsification du permis de travail »… Je ne peux m’empêcher de réfléchir à ce que ces femmes, de mon âge, parfois plus jeunes, ont commis pour se retrouver en prison.
***
Les semaines passent et les filles nouent une relation de plus en plus forte avec ces appareils photo qu’elles ne peuvent apprivoiser qu’une fois par semaine, au cours des deux heures de notre visite. G. s’est rapidement démarquée des autres. Elle se promène de longues minutes, avec « son » Canon autour du cou, en faisant les cent pas dans l’odieuse cour moisie qui donne sur les cellules. Elle s’arrête parfois, trouve sa cible, un gobelet à café en plastique, une araignée écrasée dans un coin, un soutien-gorge fluo qui sèche sur un cintre… et clic !

***
La première fois que j’ai vu H. c’est sa noire et brillante chevelure qui m’avait interpellée. La deuxième fois que je l’ai vue je lui ai demandé si elle était nouvelle et elle m’a ri au nez en claquant un « je pensais qu’un photographe reconnaissait les gens à leurs yeux et non à leur tête ». Elle s’était voilée et je ne l’avais pas reconnue.
***
De semaine en semaine les progrès de mes élèves sont saisissants. Mis à part la technique photographique, plus ou moins maîtrisée selon l’humeur, les envies ou les efforts de chacune, c’est leur perception du lieu qui me fascine. Les barreaux qui quadrillent la cour donnent lieu aux images les plus féeriques. La flaque d’eau marécageuse et verdâtre devient un moyen de refléter, par un jeu de lumières, le pied de la fille qui fume au coin.
***
G. a 23 ans. Ses photos sont une des raisons qui nous motivent, tous les samedis matin, à nous lever tôt après la soirée arrosée du vendredi soir, pour nous rendre à l’affreuse caserne de Barbar el-Khazen, la prison de femmes à Beyrouth. Cette fille dégage une sensualité déconcertante, à la fois maternelle et de femme fatale. Jamais dans la condescendance ou l’apitoiement, elle offre pourtant sa tendresse à toute fille, femme, noire, blanche, voilée ou témoin de Jéhovah, qui, à un moment, lâche prise. Elle est la première à caresser les cheveux, à prendre une main, à sécher des larmes, elle, la « star » de la prison. Et ses photos sont exactement le reflet de cet amour absolu pour l’être humain et de l’imposante confiance en soi qui l’habite. G. a rendu à la prison l’art qui lui manquait.
***
R. a 55 ans, quatre enfants, dont deux qui sont mariés et qui habitent à l’étranger. Le petit dernier a passé son bac cette année. R. n’a jamais participé aux cours de photos. C’est la plus ancienne détenue. 10 ans… Dix longues années au cours desquelles elle n’a jamais souri, ne s’est rapprochée de personne, a brodé des centaines de serviettes aux motifs de tous genre. « Je veux ressortir exactement comme quand je suis rentrée. Aucune prisonnière ne pourra devenir mon amie, je n’accepte aucune confidence, je n’en fais pas non plus. Cette prison ne me souillera pas. Rester pure. Propre. Digne. » R. s’est raccrochée à la vie à travers la propreté, l’ordre, le rangement. Elle passe des heures entières à laver, frotter, astiquer tous les recoins de sa cellule. « Cette prison ne me souillera pas… »
***
H. a 34 ans. Sa mère est arrivée au Liban il y a une vingtaine d’années pour travailler chez une riche famille de la bourgeoisie beyrouthine. « Elle m’a transmis son amour pour le ménage, pour le repassage de chemises qui coûtent cinq fois mon salaire et le récurage des toilettes ». H. l’a donc suivie au pays du Cèdre « pour perpétrer le métier de mère en fille ». J’ai du mal à sourire à ses blagues et ça l’amuse. Tout l’amuse d’ailleurs. Surtout nous, les petites filles de riches familles bourgeoises, qui donnons des cours de photos aux « bonnes » que nos parents ont jetées en prison pour le vol d’une montre, d’un mascara, d’un cheese-cake, ou que sais-je.
***
Le contact physique, le toucher, une caresse… Ces gestes qui font partie de notre quotidien – une poignée de main au bureau, une bise d’un ami, les bras d’un amoureux – à travers des codes très bien délimités prennent en prison une dimension beaucoup plus libre et libérée. La frontière entre flirt et réconfort ne se pose pas. Toucher l’autre devient nécessaire, vital. Le « visiteur » qui découvre le lieu pour la première fois peut être désorienté de cette perte de repère par rapport à ce qui est admis à l’extérieur. Mais il l’oublie vite, car de ces femmes qui se tiennent par la main se dégage presque un geste de résistance. Parmi mes premières élèves, une en particulier m’avait marquée car dès le départ elle m’avait confié ne pas s’intéresser à la photo. Pourtant elle arrivait la première, s’asseyait à côté de moi et me prenait la main. Elle ne la lâchait qu’au bout de deux heures, une fois le cours terminé.
***
R., la plus ancienne des détenues, qui ne s’est jamais confiée à personne, qui a voulu rester « pure », « propre », « digne », m’a avoué un matin, alors qu’elle tendait son linge. « La première chose que je ferai en sortant d’ici est me diriger tout droit vers la mer, toute seule, pour lui crier tout ce que j’ai tu pendant dix ans. »
***
Un an s’est écoulé. La majorité de « nos » filles sont sorties et nous ne les reverrons peut-être plus jamais. Quand on débarquait les samedis matin dans le long couloir glacial, elles attendaient frénétiquement derrière la porte de leur cellule que la gardienne débloque le cadenas. Elles nous faisaient sentir qu’on était leur bouffée d’oxygène. Maintenant que le projet touche à sa fin, je me rends compte qu’elles vont me manquer plus que moi à elles. Et c’est tant mieux. Ça voudra dire qu’elles sont vraiment sorties et que la vie recommence, avec ou sans photos, peu importe ! « Vitesse d’obturation », « focus », « ISO » n’étaient finalement pour la plupart que des mots auxquels se raccrocher, des outils pour effacer d’autres mots moins beaux qui résonnaient dans leurs têtes. Quelques-unes pourtant, j’en suis sûre, seront de grandes photographes. Une en particulier. Et ça, c’est notre plus belle victoire.
FIN
Dans le cadre des activités de l’ONG libanaise Zakira, qui promeut le développement social de certaines catégories de personnes en situation d’exclusion à travers l’apprentissage de la photographie, est né le projet «Al Nouzha » en 2012. L’objectif, donner pendant un an des cours de photo aux femmes de la prison Barbar el-Khazen à Beyrouth. J’ai participé au projet avec Ramzi Haidar, le fondateur de Zakira, et cinq jeunes femmes photographes. « J’irai crier à la mer » ne prétend pas être un compte rendu scientifique de ces douze mois, mais plutôt une compilation d’impressions et de sensations personnelles.