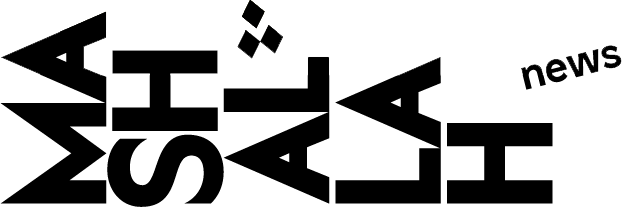Une presse opprimée
Avec le réalisateur Sedat Yılmaz

Le 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse.
Sedat Yılmaz est un réalisateur turc qui fait des films politiques et le revendique ouvertement. Né à Malatya, il arrive à Istanbul alors qu’il n’a que 9 mois. Après des études d’ingénieur puis de cinéma qu’il abandonne successivement, il monte avec un ami de la fac une société de post-production fournissant des services techniques au secteur de la publicité. C’est grâce à cette source de revenu qu’il peut financer ses projets de film.
Après un documentaire, Kelepçe (Menottes, 2002), et un court-métrage, il vient de réaliser Press, son premier long-métrage qui a remporté trois récompenses en avril lors du dernier festival international du film d’Istanbul. Le film raconte la vie de la rédaction du journal Özgür Gündem (L’Agenda Libre) à Diyarbakır au début des années 90 alors que les pressions sur les journalistes se font de plus en plus menaçantes, poussant ces derniers à prendre des décisions cruciales. Le réalisateur a choisi comme titre un mot anglais, Press, en raison de son double sens qui évoque à la fois le monde du journalisme et les pressions dont il est souvent victime. Au cours des deux années d’existence officielles de Gündem (de 1992 à 1994), trente de ses journalistes ont été assassinés.
Le film raconte la vie de la rédaction du journal Özgür Gündem à Diyarbakır au début des années 90 alors que les pressions sur les journalistes se font de plus en plus menaçantes, poussant ces derniers à prendre des décisions cruciales.
Que ce soit dans vos précédentes réalisations ou pour Press, pourquoi vous intéressez-vous, à des sujets politiques ?
Ce choix de faire un cinéma politique n’est évidemment pas un hasard. Je suis moi-même un militant socialiste. Je préfère me définir comme « socialiste » plutôt que d’employer l’expression d’ « extrême-gauche » qui, en Turquie, est connotée très négativement et équivaut, pour l’État, à dire : « ce sont les méchants ». Autrement dit, c’est un euphémisme pour désigner les terroristes. Dans les années 90, j’ai participé au mouvement étudiant et j’ai également pris part à plusieurs actions politiques.

Comment vous est venue l’idée de faire un film sur la situation à Diyarbakır au début des années 90 à travers la vie de la petite rédaction du journal dissident Gündem ?
Je n’ai jamais vécu dans l’Est de la Turquie et je n’ai jamais fait de journalisme non plus. Le choix de Diyarbakır s’imposait dans la mesure où cette ville était le cœur de la région placée en « état d’urgence » en raison du conflit entre la guérilla kurde du PKK et l’armée turque [L’état d’urgence a été levé en 2002]. Cette ville est donc particulièrement représentative de toutes les sortes d’exactions, de violences et de crimes qui se sont déroulés dans cette région. Quant au journal dissident Gündem, il a une place très importante dans l’histoire de la presse turque car c’est le journal qui a enregistré le plus de pertes en Turquie durant cette période conflictuelle : trente de ses reporters on été tués.
Je suis moi-même un militant socialiste … en Turquie, est connotée très négativement et équivaut, pour l’État, à dire : « ce sont les méchants ».
J’ai choisi de raconter cette histoire par l’intermédiaire du journalisme parce que tout ce qui a été vécu dans cette région au début des années 90 pouvait être décrit au travers du métier de journaliste. Un reporter travaille sur n’importe quel type d’information, c’est son métier, et j’ai profité de cela pour mon récit. Par exemple, il suffisait, pour parler d’un événement, de montrer le titre d’un article ou d’un fait divers, ou alors d’assister au déchiffrage d’une cassette audio. Or, si j’avais choisi un scénario plus classique, je n’aurais pas pu utiliser tous ces avantages et je courrais alors le risque d’une trop grande dispersion. Choisir l’angle du journalisme était aussi un moyen d’éviter certaines pressions émanant du gouvernement ou des militaires.
À quelles pressions faites-vous allusion ?
Je pense surtout aux attaques juridiques qui auraient pu venir de l’État en raison de l’utilisation de certaines images. Le journalisme est donc un bon moyen d’établir une certaine distance avec ce que l’on décrit. Par exemple dans le film, un journaliste revient avec la photo de militaires brandissant, tels des trophées, des porte-clés fabriqués à partir de lobes d’oreille qu’ils ont coupés. Montrer une telle scène de façon directe m’aurait exposé davantage. De plus, financièrement, le budget restreint du film ne me permettait pas de tourner de très coûteuses scènes d’action et de combat. Pour toutes ces raisons, le journalisme s’est imposé comme un point de vue fort utile.

Le journal Gündem est-il un journal connu en Turquie ?
Le journal Gündem a été fondé en 1992, douze ans après le coup d’État de 1980. Il a ensuite été fermé en 1994 sur décision de justice et il a rouvert en avril après la sortie du film. C’était le premier journal quotidien turc qui s’adressait aux dissidents. Il y avait au sein de la rédaction de nombreux socialistes ainsi que des gens issus du mouvement kurde. Tous les médias, tous les gens qui font du journalisme connaissent cela également mais ils n’en parlent jamais.
Faire du journalisme à Diyarbakır, c’est une obligation quasi morale afin de faire entendre la voix des gens qui vivent là-bas et de parler de ce qu’ils ont vécu.
Fırat, le personnage principal du film, est un jeune garçon et l’homme à tout faire au sein de la rédaction où il apprend peu à peu le métier de journaliste. Pourquoi avoir choisi d’en faire le héros de votre film ?
Pour moi, ce personnage est caractéristique d’un certain type de situation : plusieurs jeunes garçons commencent, comme lui, par distribuer un journal avant d’entrer plus tard dans le comité de rédaction de ce même journal. C’est un personnage en qui beaucoup de gens se reconnaissent. Fırat est à la fois tout le monde et personne. Mais la façon dont il aborde le journalisme n’a rien à voir avec l’exercice du même métier à Istanbul. Pour Fırat, le journalisme n’est pas du tout un choix de carrière. Il est introduit ou plutôt recueilli dans ce milieu par l’intermédiaire de Faysal, un autre journaliste, alors que sa famille vient de vivre un événement grave et douloureux. Faire du journalisme à Diyarbakır, c’est une obligation quasi morale afin de faire entendre la voix des gens qui vivent là-bas et de parler de ce qu’ils ont vécu.

Vous peignez le milieu journalistique avec un impressionnant réalisme. Comment êtes-vous parvenu à une telle vraisemblance ?
Comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais fait de journalisme et je n’ai aucune relation personnelle avec le journal Gündem. Mais à Istanbul, j’ai fréquenté plusieurs rédactions de journaux hebdomadaires socialistes pour lesquels travaillaient des amis à moi. Je connais donc ce milieu par leur intermédiaire. Je suis parti du principe qu’à Diyarbakır, le journal Gündem devait fonctionner à peu près de la même façon mais toutes mes observations proviennent de la presse socialiste à Istanbul. J’ai ensuite adapté au contexte de Diyarbakır des détails observés au sein de ces journaux socialistes car le mouvement kurde et le mouvement socialiste sont pour moi comme deux enfants d’un même quartier. Leur cause n’est pas si éloignée et bien qu’ils aient été éduqués dans des environnements différents, leurs cultures se ressemblent. Ce sont des milieux populaires et la façon dont sont traités ces dissidents en Turquie est plus ou moins la même.
À cette époque et dans cette région, il n’y avait pas d’autre alternative pour faire du journalisme. Faire paraître un journal dissident, c’est-à-dire raconter réellement ce qui se passait alors dans cette région, signifiait risquer sa vie.
Dans le film, alors que les membres de la rédaction reçoivent de plus en plus de menaces de mort, un des journalistes dit que la vérité résiste aux balles. Comment commenteriez-vous cette forme de résistance à tout prix ?
Le journalisme qui est décrit dans le film est un journalisme engagé. Ce qui compte pour les journalistes de Gündem, c’est de faire paraître leur journal le lendemain à n’importe quel prix. Il ne s’agit pas de dire que le journalisme engagé est plus important que la vie humaine, mais de raconter ce qui s’est passé à Diyarbakır au début des années 90 dans un milieu journalistique militant. Si ces journalistes ont pu faire ce qu’ils ont fait, c’est-à-dire en risquant leur vie à chaque instant, c’est en raison d’un contexte politique et social bien particulier. Un tel engagement, au péril de la vie, est inimaginable pour la plupart des journalistes aujourd’hui. Mais à cette époque et dans cette région, il n’y avait pas d’autre alternative pour faire du journalisme. Faire paraître un journal dissident, c’est-à-dire raconter réellement ce qui se passait alors dans cette région, signifiait risquer sa vie.

Dans le film, les journalistes de Gündem se voient en fait comme des membres du mouvement kurde. Ils assument les risques inhérents à leur métier bien qu’ils ne soient pas des journalistes de formation. Les autres journalistes de la région qui travaillent pour les journaux nationaux, Hürriyet ou Sabah par exemple, ne seraient pas prêts au même sacrifice. Mais pour les journalistes de Gündem, il s’agit, par le biais du journalisme, de faire entendre la voix du mouvement kurde et des gens vivant dans la région de Diyarbakır. Le journalisme est conçu comme un autre moyen de résistance. Car à cette époque, suivre les annonces officielles du chef d’état-major et de la presse nationale ne suffit évidemment pas pour savoir ce qui se passe. Sous les conditions de l’époque, un tel journalisme était nécessaire et tout le monde a appris ce qui se passait dans cette région grâce au journal Gündem.
Les gens m’ont souvent dit qu’ils savaient qu’il se passait des choses dans cette région mais qu’ils n’imaginaient pas que c’était à ce point-là.
La situation de la presse turque a-t-elle changé aujourd’hui ?
Oui, car la situation de la presse « mainstream » dépend de la conjoncture politique de la Turquie. Dans les années 90, l’appareil d’État était dirigé par un centre unique et il y avait une seule ligne politique qu’il fallait suivre. Mais aujourd’hui, au sein de cet appareil, plusieurs tendances peuvent s’exprimer. Et ces différentes tendances sont reflétées au sein des médias. Disons que l’on peut parler aujourd’hui de deux tendances politiques principales (le CHP, parti kémaliste, et l’AKP, parti islamo-conservateur au pouvoir) qui n’empêchent pas que d’autres voix se fassent également entendre. Mais cela ne signifie pas pour autant que la presse est libre en Turquie.

La bonne réception reçue par le film, tant chez les critiques que chez les spectateurs, témoigne-t-elle, selon vous, d’une certaine prise de conscience, par l’opinion publique, du problème de la liberté de la presse en Turquie et d’une meilleure compréhension du problème kurde ?
Les médias connaissent le journal Gündem et les problèmes évoqués par le film. Mais Press a attiré l’attention sur certains faits. En Turquie, tout le monde avait plus ou moins une idée de ce qui se passait dans la région de Diyarbakır au début des années 90 mais le film a peut-être fait prendre conscience plus profondément de ce que tout le monde savait déjà confusément. Les gens m’ont souvent dit qu’ils savaient qu’il se passait des choses dans cette région mais qu’ils n’imaginaient pas que c’était à ce point-là. Cette prise de conscience, c’est d’ailleurs ce à quoi devrait servir l’art selon moi. Le film a ainsi pu faire sentir que les Kurdes, ce ne sont pas seulement des gens armés engagés dans une résistance contre le gouvernement turc, mais aussi des gens comme tout le monde, comme vous et moi, qui rient, pleurent, s’amusent, ont peur…
Pour moi, l’histoire du socialisme, l’idée socialiste, c’est cela qui compte et mon identité ethnique n’a rien à voir là-dedans. Ce n’est pas une question d’être kurde ou turc, mais une question de liberté.
Êtes-vous considéré comme un réalisateur militant en Turquie ?
On ne me voit pas comme un réalisateur militant mais comme quelqu’un qui fait des films politiques et je revendique moi-même cette appellation. Les Kurdes me demandent souvent, à la suite de la projection, si je vois ce travail comme un film kurde, en faveur de la cause kurde. Mais quand les gens apprennent que je ne suis pas kurde, leurs questions changent et ils me demandent alors pourquoi j’ai fait un tel film si je ne suis pas kurde ! Pour eux, quelqu’un qui fait ce genre de films doit forcément être kurde. Mais pour moi, l’histoire du socialisme, l’idée socialiste, c’est cela qui compte et mon identité ethnique n’a rien à voir là-dedans. Ce n’est pas une question d’être kurde ou turc, mais une question de liberté. Les problèmes rencontrés par les Kurdes doivent se résoudre dans la rue : il faut que les Turcs comprennent les Kurdes afin de trouver une solution sans passer par le conflit armé. J’espère que le film contribuera à faire sentir aux Turcs ce que vivent les Kurdes et à leur faire comprendre que finalement, ils ne sont pas différents d’eux.

J’imagine que la plupart des questions que l’on vous pose ont trait au sujet du film et à la politique, laissant dans l’ombre votre projet artistique. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Je suis en effet dérangé par le fait qu’on ne parle que de l’aspect politique du film et absolument pas de son aspect artistique. Mais étant donné le sujet du film, c’est inévitable. Concernant l’esthétique du film, nous avons été sensibles à plusieurs préoccupations. Tout d’abord, comme l’histoire racontée est très violente en elle-même, nous avons essayé de ne pas en rajouter en optant pour un langage qui ne joue pas sur la corde sensible et le pathétique. Ce langage essaye de parler du sujet de façon assez distanciée et froide. Par exemple, il n’y a pas de musique dans le film, y compris pour le générique.
On a voulu que les gens sentent l’ambiance menaçante, inquiétante de Diyarbakır à cette époque.
Ainsi, nous avons choisi un style opposé à ce qui était filmé, le plus objectif possible, ce qui ne signifie absolument pas qu’il n’y a pas de prise de position dans le film. L’objectif n’était pas non plus de transmettre ce qui s’est passé à Diyarbakır au début des années 90 de façon scrupuleusement exacte. Nous avons davantage voulu recréer et communiquer l’atmosphère particulière de cette époque. Nous avons créé une histoire basée sur des faits réels. On a voulu que les gens sentent l’ambiance menaçante, inquiétante de Diyarbakır à cette époque. Et cela a été possible grâce au jeu des acteurs qui est très naturel et a permis de transmettre au mieux le réalisme et l’authenticité de la situation.
Qu’allez-vous faire des prix que vous avez reçus, avez-vous un nouveau projet de film en tête ?
Les prix que nous avons reçus ne représentent pas une grosse somme d’argent. Ils ne vont pas servir à financer un prochain film mais plutôt à couvrir les frais de Press et encore, pas entièrement. Je veux bien sûr continuer à faire des films mais je ne sais pas comment ni quand car les films comme Press ne sont pas des films qui reçoivent une forte publicité ni qui génèrent beaucoup d’entrées. Ce genre de films n’atteint pas les 100 000 spectateurs. Mais ce qui est sûr, c’est que tant qu’il m’est possible de générer de l’argent avec ma société de postproduction, je vais continuer à faire des films. J’ai d’ailleurs déjà une idée de film concernant le coup d’État du 12 septembre 1980 en Turquie.