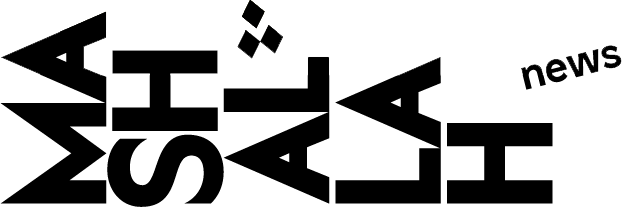Le printemps algérien confisqué
C’est en plein automne qu’a fleuri douloureusement le premier «printemps arabe». En Octobre 1988 en Algérie. Il s’est terminé par des cris et du sang quelques années plus tard. La révolte populaire du 5 Octobre 88 a été l’événement le plus marquant depuis l’indépendance du pays en 1962. Aucune responsabilité politique n’a été assumée à ce jour dans le pays sur cette tragédie qui a jeté les algériens, notamment la jeunesse, dans la rue. Aux manifestations pacifiques ont succédé les attaques d’édifices publics et de symboles de l’Etat. Les rues étaient jonchées de pneus en feu, de voitures incendiées, de barricades. Des youyous de femmes fusaient des balcons d’où elles lançaient des objets sur les forces de répression. Des salves percutaient les murs, des blessés tombaient, des ambulances gyrophares alertes se précipitaient vers les hôpitaux… Journées de deuils.
«Le chahut de gamins», propos d’un ministre, s’est avéré un véritable ouragan de colère. L’état de siège est proclamé le 6 octobre. Officiellement, le bilan de l’intervention de l’armée, sous le commandement du général Khaled Nezzar, avec des engins et chars qui prenaient possession des coins stratégiques des villes, est de 169 morts. D’autres sources, notamment médicales, avancent le chiffre de 500 morts et de plusieurs milliers de blessés. La répression, par son ampleur inattendue, le nombre d’arrestations et l’usage de la torture, a profondément choqué la population, consommant sa rupture avec le régime.
Durant la décennie quatre-vingt, le régime algérien se lance dans l’Infitah (ouverture économique). Le libéralisme s’affirme graduellement sur l’économie du pays, par la privatisation de quelques secteurs économiques, à l’exemple du marché des fruits et légumes. Avec une population composée pour 75 % de moins de 25 ans et des mouvements associatifs et démocratiques en gestation, c’est dans un contexte d’explosion démographique aggravé par l’échec de la révolution agraire et l’exode rural qui s’ensuit, que s’affiche la contestation du régime.
Avec le contre-choc pétrolier de 1983, puis de 1986, et la récession mondiale, sachant que l’économie algérienne était basée sur l’exportation des hydrocarbures (97% des recettes), le régime imposa une politique d’austérité sociale. Les gens se contentaient de peu, mais maigre fut ce peu.
L’aggravation des conditions de vie, avec la pénurie de matières premières (tantôt le sucre ou le café, tantôt les cigarettes et la chique ou l’huile de table) et la crise du logement, déclencha des émeutes. Des manifestants se soulevèrent à Oran en 1983 et puis à Constantine et Sétif en 1986. A l’époque, les émeutes à la suite de matchs de football étaient légions, où les masses des déshérités s’affrontaient avec la police et attaquaient les marchés publics pour s’accaparer des vivres. Des familles de plusieurs membres s’entassaient dans des espaces exigus et « on dormait à tours de rôle » ironisait-on. Face à l’étouffement et la peur de la « Sécurité Militaire », la résistance s’exprimait aussi par des blagues sur le président, tellement innombrables qu’elles circulaient comme une production industrielle. Ces signes avant-coureurs de la crise se soldèrent par la révolte généralisée d’Octobre et le mouvement arracha alors l’ouverture démocratique. Le pays était comme ensorcelé par la liberté. Des associations virent le jour, des journaux au ton virulent se diffusèrent par milliers et la critique du système passa même sur l’unique chaîne télévisuelle du pays. Toutefois, les poches restaient vides, alors qu’en face des bus, infectés de sueurs, circulaient les premières voitures de luxe, narguant par leur présence même le regard des démunis.
Les thèses dominantes sur les causes de cet événement se résument globalement à la théorie du complot qu’affectionne l’élite politique et intellectuelle. Certains affirment que l’entourage du président Chadli Bendjedid a œuvré à faire sortir le peuple dans la rue pour réclamer des réformes que lui refusait l’aile conservatrice du FLN. Pour d’autres, c’est la main étrangère qui était derrière ce chaos. Les luttes intestines faisaient rage à l’intérieur du régime et du parti unique où réformateurs et bureaucrates conservateurs s’affrontaient sur le rythme à donner à l’ouverture économique et politique, mais sans saisir l’accumulation croissante de frustrations, d’injustices et la fermeture politique comme causes premières des mouvements de révoltes.
Ces théories dégagent un mépris du mouvement populaire, considéré comme mineur et incapable de se prendre en main. Cette lecture perdure de nos jours, notamment en l’absence d’un champ intellectuel autonome. La montée de l’islamisme et la tragédie subie par le pays ne furent pas pour arranger les choses. Octobre continue ainsi d’être vécu comme une malédiction par une grande partie de l’élite, qui estime par ailleurs que l’intégrisme a pu se consolider grâce à la multiplication des partis politiques. La soixantaine de partis légalisés par le régime est considérée comme une manipulation, chiffre d’ailleurs mineur comparé par exemple à l’existence d’environ trois cents partis en France, remettant ainsi implicitement en cause le principe démocratique. Le lexique de la manipulation revient comme une rengaine, à chaque commémoration de l’événement, dans les communiqués même des partis démocratiques, dans la bouche des analystes et dans les écrits journalistiques.
Le pouvoir céda donc sur le pluralisme, sans prendre en charge les problématiques sociales, et accorda par ailleurs la liberté de création d’association à caractère religieux. La nébuleuse intégriste, entrée en scène durant les jours suivant les émeutes d’Octobre, et bien que très minoritaire, en profita pour se doter d’un appareil politique, le Front Islamique du Salut (FIS). Ce dernier sut au fil du temps prendre en mains la radicalité de la plèbe et son refus du régime. Son discours populiste radical, relayé par la floraison des mosquées, publiques et privées, trouva un fort écho dans la population, dans un contexte d’effondrement du bloc de l’Est et la défaite du rêve socialiste. Les premières élections pluralistes en Algérie allaient confirmer la mainmise du FIS sur le vote populaire. En juin 1990, lors des élections locales et wilayales (départementales), ce parti, avec un système électif majoritaire, remporta 833 communes sur les 1551 et 32 départements sur les 48, avec presque trois millions et demi des voix exprimées sur douze millions d’inscrits. Bien que le FIS, un an après ait perdu un million de voix, lors des élections législatives en décembre 1991, il réussit néanmoins à rafler la mise, en prenant la majorité des sièges du parlement.
Le FIS, qui n’était jamais parvenu à s’implanter dans le monde du travail, malgré la création du Syndicat Islamique des Travailleurs (SIT), resta cependant le parti le plus influent auprès de la masse des déshérités. Assuré de sa puissance et radicalisé par sa base, le FIS entama une grève générale insurrectionnelle, plutôt suivie par l’administration telles que les Communes qu’il détenait, pour revendiquer des élections présidentielles anticipées. L’éveil du mouvement ouvrier, la combativité courageuse des femmes et l’organisation de plusieurs manifestations politiques d’envergure qui auraient pu ouvrir la voie au changement furent stoppés nets par le régime qui préféra choisir l’arrêt du processus électoral. C’est alors que commença la seconde tragédie seulement quatre ans après l’ouverture démocratique. Le rideau était tombé et tous les espaces d’expression acquis furent réduits. L’état d’urgence fut décrété en janvier 1992 et l’armée prit en mains le devenir du pays, soutenue par une partie de la classe politique démocratique. L’affrontement fut impitoyable et le bilan de ce conflit fut lourd en vies humaines, en traumatismes et en conséquences politiques.
Mohammed Yefsah
Extraits du texte original publié par Babelmed, partenaire de Mashallah News.